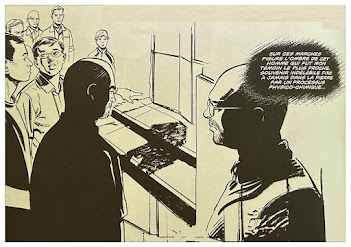Didier Alcante / Laurent Frédéric Bollée /
Denis Rodier. – La bombe. – Grenoble :
Glénat, 2020. – 472 pages.
Roman graphique
Résumé :
Le 6 août 1945, une bombe atomique anéantit
Hiroshima.
Un événement historique et tragique qui mit
fin à la guerre et fit entrer l'humanité dans une nouvelle ère.
Mais dans quel contexte cette bombe fut-elle
créée ? Comment fut prise la décision de la larguer ? Et pourquoi sur Hiroshima
? Quels furent les acteurs majeurs - illustres ou méconnus - de ce drame ?
Quels furent les effets de l'explosion? Que vécurent les victimes ?
Des mines d'uranium du Katanga jusqu'au Japon, en passant par
l'Allemagne, l'Angleterre, la Norvège, l'URSS et les États-Unis; des
laboratoires de Los Alamos aux bombardiers du Pacifique, l'incroyable histoire
vraie de la bombe atomique !
Commentaires :
« La
bombe » est un roman graphique duquel il est impossible de décrocher et
que tous devraient lire pour apprendre comment ce projet de fission nucléaire
est né dès 1939 jusqu’au largage en 1945 de l’engin létal sur deux villes du
Japon.
Courez l’emprunter à votre bibliothèque
municipale – au besoin, demandez qu’elle en fasse l’acquisition – ou procurez-vous
la auprès de votre librairie indépendante.
Cette BD à vous couper le souffle brille par le souci des faits historiques auxquels se sont astreints les scénaristes (Alcante et LF Bollée) et le réalisme des dessins en noir et blanc – choix tout à fait approprié – aux effets dramatiques ressentis de planche en planche, suscités par l’art graphique du Québécois Denis Rodier). Comme cette scène du débarquement allié en Normandie le 6 juin 1944.
Il a fallu plus de cinq ans de recherches, de
documentation, de création littéraire et artistique, de validation en
validation pour livrer aux Éditions Glénat un manuscrit hors du commun traduit
dans 18 pays et vendu à plus de 150 000 exemplaires. On y retrouve les principaux
protagonistes politiques, scientifiques, militaires de l’époque, incluant la
principale intéressée, l’énergie nucléaire, la bombe, narratrice du récit qui trépigne
à démontrer sa puissance à l’Humanité.
Dans le prologue, après un résumé en quelques
images, du « big bang » aux premières recherches sur l’utilisation
pacifique de l’uranium, le lecteur fait la connaissance des deux scientifiques dans
l’entourage d’Albert Einstein qui joueront un rôle clé dans la fabrication
d’une nouvelle arme d’une puissance effroyable : le projet Manhattan :
·
le
physicien hongrois Leó Szilárd, professeur à la Friedrich-Wilhelms-Universität
de Berlin ; en 1933, il gagna précipitamment Londres pour échapper aux
persécutions nazies ; il deviendra citoyen américain 10 ans plus tard ; son
principal champ de recherche : la réaction nucléaire en chaîne ;
·
le
physicien italien Enrico Fermi, ardent défenseur de la physique quantique qui
orienta ses recherches vers la physique nucléaire ; en 1939, il émigra aux États-Unis avec toute
sa famille pour échapper aux lois anti juives touchant sa femme ; il est
embauché par l'université Columbia où il enseignait avec son collègue Leó Szilárd.
Les dernières pages du prologue sont
consacrées à l’introduction d’un personnage fictif que les scénaristes ont
imaginé : Naoki Morimoto, travailleur à l’usine Toyo Cork Kogyo, à cinq
kilomètres du centre d’Hiroshima, qui, en compagnie de ses deux fils, se
retrouve bien malgré lui au cœur de cette terrifiante histoire.
Au passage, deux cases du prologue nous
apprennent l’origine du mot « fascisme » :
Le récit est ensuite découpé en six
chapitres :
·
Chap1tre :
Avec l’appui d’Albert Einstein, Leó Szilárd souhaite convaincre le président Roosevelt
d’acheter la totalité de l’uranium congolais pour la conception d’une bombe
atomique. Au même moment, en Angleterre, on s’inquiète d’un projet similaire en
Allemagne alors qu’un tel type d’arme intéresse également la Russie et le
Japon. L’attaque de Pearl Harbor en décembre 1941 au cours de laquelle Satoshi,
le fils de Naoki Morimoto pilote un des bombardiers.
·
Chap2tre :
Le colonel Groves qui dirigeait le chantier de construction du Pentagone est
nommé responsable militaire du projet Manhattan. On apprend l’existence d’une
usine allemande de fabrication d’eau lourde en Norvège. Un commando britannique
est envoyé sur place avec comme mission de la détruire. L’opération est un
échec.
· Chap3tre : Les installations de Los Alamos sont en construction. Le général Groves n’a pas confiance en Leó Szilárd et en un certain Robert Oppenheimer qui vient de se joindre à l’équipe du projet Manhattan. Une deuxième tentative de destruction de l’usine d’eau lourde de Norvège par des bombardiers américains est un échec total. Les relations scientifiques-militaires sont de plus en plus tendues, ces derniers doutant de la fidélité des chercheurs. Quatre mois avant le débarquement en Normandie, le commando britannique réussit à détruire le convoi ferroviaire qui transporte l’eau lourde de Norvège vers l’Allemagne.
· Chap4tre : Franklin Delano Roosevelt est réélu président pour un 4e mandat et choisit Harry Truman comme vice-président. Ce dernier qui tente de connaître le projet Manhattan. Un espion américain informe les autorités russes de l’avancement du projet. Deux cobayes sont sacrifiés pour évaluer les effets du plutonium sur le corps humain. Décès subit de Roosevelt. Truman devient président. Mussolini est fusillé. Hitler se suicide. L’opération Alsos permet d’arrêter le Werner Heisenberg impliqué dans les recherches allemandes sur la bombe. Naoki Morimoto, dans un camp militaire, est emprisonné pour avoir aidé un de ses compatriotes plus âgé qui peine à réaliser les exercices d’entraînement au combat. Le fils Morimoto meurt dans une opération kamikaze ratée sur le navire de guerre américain USS Indianapolis.
·
Chap5tre :
On s’interroge sur les cibles à atteindre au Japon. Les tests d’injection du
plutonium sur des cobayes humains se poursuivent. Leó Szilárd s’oppose au
largage de la bombe sur une ville japonaise. Il cherche des appuis pour
proposer plutôt de faire une démonstration de la puissance de frappe américaine.
Destruction d’une partie de la flotte américaine à Okinawa. En route pour la
conférence de Posdam. Truman constate la destruction de Berlin. Premier test
d’explosion atomique concluant (essai Trinity) dans la région du désert
d'Alamogordo appelée la vallée désertique de Jornada del Muerto (Voyage de l'homme mort) au Nouveau-Mexique.
·
Chap6tre :
Conférence de Postam. Le USS Indianapolis transporte la bombe de San Francisco
à l’île de Guam. Celle-ci est transférée sur une barge qui l’amène à quai. Elle
sera embarquée dans un bombardier sur la base américaine de Tinian. Le USS
Indianapolis est la cible d’un sous-marin japonais : 879 des 1196 hommes
d’équipage sont morts. La bombe est en route pour Hiroshima. Naoki Morimoto qui
a finalement été libéré du camp militaire se rend à une banque de Hiroshima pour
retirer de l’argent. Il s’assoit sur les marches en attente de son ouverture.
La bombe est larguée.... On connaît la suite. Aux États-Unis, tous se
réjouissent du résultat obtenu. Au grand dam de Leó Szilárd qui regrette
d’avoir contribué à un tel désastre.
Quant à l’épilogue, il met en évidence les dégâts : plus de 200 000 morts rien qu’à Hiroshima. La bombe narratrice fait un bilan :
« Je repense à ces personnes qui m’ont
accompagné durant tout ce temps... Je les ai parfois considérées comme mes
marionnettes dont je tirais les fils »
Elle rappelle la fin de carrière et de vie de
Robert Openheimer, d’Enrico Fermi, du physicien
allemand Werner Heisenberg, des membres du commando
du groupe Grouse et Gunnerside, du général Leslie Groves, de Paul Tibbets, pilote du
bombardier qui l’a larguée, de Charles B. McVay III, capitaine de l’USS
Indianapolis, de Klaus Fuchs, l’espion de Los
Alamos, de Ebb Cade et d’Arthur Hubbard,
premiers cobayes à avoir testé à leur insu l’impact du plutonium dans le corps
humain, de Leó Szilárd, de Naoki Morimoto
et l’ombre qu’il a laissé sur les marches d’une banque d’Hiroshima au moment de
l’explosion atomique.
« Souvenir indélébile fixé à jamais dans la
pierre par un processus physico-chimique ».
En postface, Didier Alcante raconte comment
est né ce projet de roman graphique avec comme objectif de livrer un document
de mémoire dont la véracité historique serait incontestable :
« Dès le début nous nous sommes dit que le
sujet nous imposait une totale rigueur, et ce tant au niveau historique que
scientifique. Que ce soient les faits, les dates, les personnages, mais
également les lieux, les bâtiments, les véhicules, les uniformes... tout a été
vérifié à maintes reprises. Bien sûr, il nous a parfois fallu, pour des raisons
narratives, recréer des dialogues, remettre en scène, synthétiser plusieurs
réunions en une seule, ce genre de choses. Mais fondamentalement, tout ce que
vous venez de lire est authentique ! Dans ce souci de coller au mieux à la
réalité, nous avons attendu d'avoir visité Hiroshima (à l'été 2018) avant de nous
attaquer aux séquences s'y déroulant. Assister ensemble aux cérémonies
commémoratives du 6 août restera certainement, pour chacun de nous, une étape
marquante de notre vie d'auteur. Déposer, le soir, une lanterne flottante sur
la rivière au pied du dôme, la voir s'éloigner et rejoindre des centaines
d'autres, vous submerge d'émotion. »
Pour sa part, Denis Rodier décrit sa démarche, affirmant entre autres qu’il a « même créé un leitmotiv circulaire au début de plusieurs scènes (une montre, la palette d'une artiste, une balle de baseball)...
... en allant parfois
jusqu'à évoquer un champignon d'explosion nucléaire (la fumée d'une cigarette,
un jaune d'œuf crevé qui dégouline).
Tout cela en guise de ponctuation, de rythme. »
Quant à LF Bollée, dans un texte intitulé
« Hiroshima mon cheminement »,
il nous invite à écouter l’hallucinante pièce musicale appelée « Thrène à la mémoire des
victimes d’Hiroshima » composée en 1960, par le Polonais Krzysztof
Penderecki.
En finale, une bibliographie complète le tout
en fournissant les références de 34 livres, 6 articles/magazines, 3 bandes
dessinées, 18 sites Internet et 3 documentaires qui portent sur le sujet.
Pour prolonger l’aventure de « La
bombe », trois courtes vidéos sont accessibles à d’un code QR :
·
Les
créateurs expliquent comment ils ont procédé pour créer et valider le récit : https://youtu.be/l-HOG-7R6uA?si=P78gAJwMQ8VUy7T4
·
Le
dessinateur Denis Rodier parle de son travail pour illustrer le récit : https://youtu.be/dvB07JvztV4?si=jWOhoU41zP8c5uLS
·
Les
scénaristes nous informent sur les étapes qui ont conduit à la mise en scène
cette histoire vraie : https://youtu.be/gzFreoOweF4?si=iqsxBU0Bqq7uBc75
Denis Rodier est un dessinateur originaire de Nominingue au Québec. Il collabore très tôt aux séries les plus populaires d’éditeurs américains comme Marvel et DC Comics. C’est son travail sur la série Superman qui est le plus remarqué, en particulier Death of Superman, lauréate de plusieurs prix. En Europe, on le connaît pour sa série L'Ordre de Dragons avec Jean-Luc Istin, et sa suite, L’Apogée des Dragons avec Corbeyran (éd. Soleil). Chez Glénat il dessine l’album Lénine pour la collection « Ils ont fait l'Histoire ».
Au Québec, vous pouvez commander votre
exemplaire sur le site leslibraires.ca et le récupérer auprès
de votre librairie indépendante.
Originalité/Choix du sujet : *****
Qualité littéraire et graphique : *****
Intrigue : *****
Psychologie des
personnages : *****
Intérêt/Émotion
ressentie : *****
Appréciation générale
: *****