Jean Lemieux. – L’affaire des Montants – Une enquête du détective Surprenant. – Montréal : Québec Amérique, 2024. – 299 pages.
Polar
Résumé :
Vendredi 20
décembre 2013. Quand un vieil ami lui demande de venir aux Îles-de-la-Madeleine
pour élucider le meurtre d’une éleveuse de moutons et de son chien, André
Surprenant s’envole sans hésiter, mais avec un certain sentiment d’urgence. Il
a promis à sa blonde qu’il serait rentré pour Noël.
Sur place,
jumelé à une jeune enquêtrice de la SQ sans expérience mais douée, Surprenant
commence le bal des interrogatoires. Le conjoint charismatique mais louche, la
meilleure amie exploitée, l’ex-mari antipathique, le faux frère jaloux,
l’animatrice de télé aux liens douteux : personne n’a d’alibi très solide.
Surtourisme, spéculation foncière, tensions
familiales, les pistes s’accumulent au même rythme que la neige. Surprenant est
hanté par les révélations récentes de sa mère, qui lui a enfin confié les
circonstances de sa conception. Sa mère flouée, cette femme assassinée, sa
collègue intimidée… les destins des femmes autour de lui s’amalgament, le
poussent à penser autrement et, qui sait, lui permettront peut-être de résoudre
l’affaire.
Commentaires :
Quel plaisir, à quelques jours de Noël, de
retrouver l’enquêteur fétiche de Jean Lemieux dans « L’affaire
des Montants », une affaire de meurtre, de moutons de pré salé, de
foin – dans le sens de fourrage et d’argent –, de cassoulet, de mafia, entre
Montréal, l’île rouge de Havre-aux-Maisons, Casablanca et Florence. Une
première enquête hivernale d’André Surprenant, la huitième, qui a entraîné son
auteur « dans de nouveaux
chemins » : sur le chemin des Montants, dans l’archipel des
Îles-de-la-Madeleine, au centre du golfe Saint-Laurent, « un lieu tranquille, où l’on entendait guère
que le frémissement des sapins sous le vent ». Une fiction enchâssée dans
une réalité historique alors qu’Angela Merkel entreprend un troisième mandat de
chancelière en Allemagne et que Vito Rizutto, qui semble
« avoir mis de l’ordre dans les
affaires de la Famille », meurt le 23 décembre 2013 à l'Hôpital du
Sacré-Cœur de Montréal des suites d'une pneumonie ou d’un empoisonnement, aucune
autopsie n'ayant été faite avant son incinération.
On accompagne dans sa recherche de la vérité
le sergent-détective transfuge de la Sûreté du Québec (SQ) qui a intégré depuis
cinq ans l’escouade des crimes majeurs du Service de police de la ville de
Montréal (SPVM), réputé pour ses « méthodes
inorthodoxes » et ses « relations
douteuses ». Dépêché sur l’archipel aux 713 naufrages, il vient en
appui, pour des raisons personnelles, à une jeune sergente-enquêtrice du poste
de la SQ de Cap-aux-Meules, « une
floune qui ne pèse pas plus de 100 livres », « cinq pieds deux pouces étirée » :
Olivia Mansour.
En cours de récit, l’auteur en profite pour
nous en dévoiler un peu plus sur les origines familiales troubles de son
protagoniste qui cumule 25 ans de carrière comme policier, a étudié à Brébeuf,
a grandi à trente kilomètres du Vermont, conduit à Montréal une BMW Z3, a habité 14 ans plus
tôt près du cap de l’Échouerie avec Maria, sa première conjointe, et leurs deux
enfants Maude et Félix « avant leur
divorce provoqué, en autres choses, par sa rencontre avec Geneviève ».
Il éprouve toujours un inconfort au genou, réfléchit mieux couché, « c’est physiologique », est amateur
de scotch whisky Macallan,
« single malt coûteux »
mais ne lève pas le nez sur un Aberlour
A’bunadh quand on lui en offre et, lorsque l’occasion se présente, touche du piano.
« À cinquante-deux ans, après plus de
vingt-cinq ans de carrière, il n'en était pas à son premier drame. Ce qui
sapait son énergie, c'était la charge cumulative. Il avait beau employer tous
les trucs, la négation, la froideur, l'humour, il était souvent en proie à des
vagues d'angoisse ou simplement de douleur, comme si son cœur, au même titre
que son genou gauche, élançait quand il était sollicité. »
Dans « L’affaire des montants », la disposition naturelle d’André
Surprenant à résoudre un crime est encore une fois mise à l’épreuve dans une
intrigue alambiquée comme peut l’imaginer Jean Lemieux. Dès son atterrissage à sur
l’île de Havre-aux-Maisons, il est rapidement confronté à la sphère personnelle
de la victime d’un meurtre énigmatique, celui d’une éleveuse de moutons et de son
chien Sol, un montagne des Pyrénées. Il devra en détricoter les « relations familiales complexes », « aboutissement d’une suite de circonstances
précises, ancrées dans un passé qui pouvait être aussi proche que lointain. »
Pour compliquer les choses, Jean Lemieux a
mis en scène une galerie de personnages très colorés dont certains auraient eu
bien des raisons pour assassiner Florence Turbide, fille de Colette Thériault et
de Rosaire Turbide (mort le 19 décembre 1975 lors du naufrage de la Rose-Angèle) :
·
Ella
Arseneau, fille de Félix Arseneau, lui aussi décédé dans le même naufrage, amie
de Florence ;
·
Octave
Loiseau, ex-conjoint de Ella Arseneau, faux-frère de Florence, Colette
Thériault ayant épousé en secondes noces Wellie Loiseau et, depuis la mort de
ce dernier en 2009, est la conjointe de Platon Longuépée, un ami de Surprenant
qui fut par le passé son entraîneur de hockey ;
·
Philippe
Santoro, italien originaire de Roquefort-la-Bédoule en banlieue de Marseille
établi aux îles en 2008, conjoint de Florence Turbide ;
·
Louis
Schofield, ex-conjoint de Florence ;
·
Delphine
Schofield, fille de Louis Schofield et de Florence ;
·
Félix
et Fabien, les fils de Florence et frères de Delphine, surnommés respectivement
« Left » et « Right » pour les distinguer selon l’orientation
de leurs courts cheveux châtains, mais appelés « en cette entité commode, les jumeaux » lorsqu’il était impossible
de les différencier lorsque leurs tuques brouillaient leurs coiffures ;
·
Albéni
Thériault, frère de Florence ;
·
Paule Greco, cheffe influenceuse de Montréal ;
·
Youssouf
Hari (Youtube), originaire de Casablance, employé de Florence ;
·
Alessandro
Vitale, professeur d’italien de Florence.
Une carte nous permet de situer le lieu du
crime et les lieux de résidences des suspects potentiels.
Suspense garanti sur 30 chapitres aux titres évocateurs jusqu’au dénouement de l’enquête, avec au passage une incontournable référence pendant la période des fêtes à la chanson « 23 décembre » du groupe de Beau Dommage.
Pour les amoureux de la langue française et
des parlures régionales, « L’affaire
des Montants » met en évidence les accents et plusieurs des mots des
insulaires. Jean Lemieux souligne au passage que « pour
des raisons qui font toujours l’objet de débats, les habitants de
Havre-aux-Maisons ont un accent principalement caractérisé par le remplacement
des R par des Y ». Par exemple : « J’étais à la veille de feymer [fermer] boutique. ».
Vous y découvrirez le sens de certaines
expressions des Madeliniennes et des Madelinots « essentiellement issus
des déportés acadiens du dix-huitième siècle, considéraient depuis des
générations que la langue parlée était leur espace de liberté :
·
un
amariné, une floune, une folle amarrable,
une personne d’en dehors, une ancêtre de l’an premier, faraud,
les coiffages, le jour craquant, la salange, un soleil de mer,
une adonnance, une sauterelle, une fiance, un kakawi, la wheelhouse, une salebarbe, un jour de
débauche, un chancre, du chiard ;
·
s’aplatir, godêmer, avoir la main dans le panier, rebardeauter,
dégolfer, capseyer, piloter un botte,
se raplomber, être plein moribe, arriver à
la bichetée, mettre en bébelles.
Ou, pour souligner la mémoire phénoménale de
l’enquêteur : « ... vous avez un
moyen disque dur ».
J’y ai appris pourquoi les éleveurs de
moutons élèvent aussi des ânes :
« On les met au pâturage avec les moutons. Les
coyotes n’aiment pas leurs hennissements. »
J’ai noté cette belle description de I'île du
Havre-aux-Maisons ...
« Ils arrivaient au sommet de la côte du
Bellevue. Devant leurs yeux, éclairée par le pâle soleil d'hiver, s'étalait I'île
du Havre-aux-Maisons, avec ses buttes et ses vallons. Voisine de l'île
centrale, où étaient concentrés les services gouvernementaux, Havre-aux-Maisons
avait toujours cultivé une singularité dont l'accent n'était que la
particularité la plus évidente. Il y avait certainement un port de pêche actif,
une vocation agricole, des boutiques et des restaurants renommés. Il y avait
surtout un esprit d'indépendance dont les racines remontaient à l'établissement
des premières familles acadiennes, plus de deux cents ans plus tôt. À
Havre-aux-Maisons, on ne se contentait pas de remplacer les R par des Y, on
n'était pas pareils. »
... du quai de la Pointe-Basse...
« Le quai était désert. Deux homardiers, leurs
francs-bords abîmés par la dernière saison, tiraient sur leurs amarres. Leurs
pareils, nombreux, avaient été remontés et affrontaient l'hiver juchés sur des
cales de bois à côté du slip. Au-delà des dolosses de béton qui protégeaient le
havre, les crêtes des vagues qui agitaient le golfe scintillaient en désordre
sous la lune. »
... et des écoles de rang converties en résidences :
« Comme beaucoup de campagnes québécoises au
début du vingtième siècle, les Îles-de-la-Madeleine étaient semées d'anciennes
écoles de rang, des bâtiments d'environ vingt mètres par dix comprenant deux
salles de classe unies par une entrée centrale surélevée. Aux Iles, certaines
avaient été démolies, d'autres avaient eu des vocations commerciales, enfin
quelques-unes avaient été converties en maisons unifamiliales. »
Jean Lemieux souligne dans la portion d’un
court dialogue l’impact des changements climatiques sur l’occupation de
certains îliens :
« J’ai déjà chassé le loup-marin, mais là, y’a
plus de glaces. »
Dans un paragraphe, il résume les transformations
socio-économiques majeures que vivent les habitants des Îles-de-la-Madeleine, « un trésor protégé par un unique
cerbère : le mauvais temps. »
« Les choses avaient changé depuis qu'il avait
quitté l'archipel, douze ans plus tôt. Ce qui était à vendre maintenant, ce
n'était plus le homard ou la saveur locale, c'étaient les îles elles-mêmes, les
maisons, les terrains, la mer et son contenu. Du fait de l'isolement et d'une
économie saisonnière, les propriétés avaient toujours été moins chères aux Îles
que sur le continent. Une vingtaine d'années plus tôt, les touristes avaient
commencé à acheter. Le phénomène ne semblait plus marginal. C'était fatal, les
plus belles côtes du Québec n'échapperaient pas à la spéculation foncière qui
affligeait l'ensemble du littoral de la planète. »
Un milieu insulaire qui autrefois savait s’autoréguler :
« Longtemps après les autochtones et les
pêcheurs saisonniers, les premiers hivernants acadiens, boat people avant
l'heure, avaient vécu pendant des décennies sans autre police que leurs
conseils de sages. Les Îles-de-la-Madeleine, isolées du monde sous la lointaine
autorité de seigneurs britanniques, s'apparentaient à un grand navire dont
l'équipage, issu de quelques familles fondatrices, avait intérêt à suivre le
règlement. »
Le médecin écrivain est aussi en mesure d’étayer
quelques critères permettant de calculer l’heure du décès d’une victime :
« Il le parcourut avec attention, y retrouva
des paramètres familiers, description du corps, flexibilité des membres,
température rectale, usage de cet outil délicat, le monogramme de Henssge pour
déterminer l'heure du décès. Les variables étaient multiples, poids de la
victime, température extérieure, météo, usage de médicaments. Surprenant avait
suffisamment d'expérience pour savoir que cette dernière était irremplaçable. »
Mon passé d’archiviste m’a permis d’apprécier
cette description des photographies de
famille :
« ... qu'elles soient éparses, regroupées en
albums ou stockées dans des nuages virtuels, [elles] ont une fonction paradoxale: instants évanescents, elles doivent, par
leur pouvoir évocateur ou leur multiplicité, raconter une histoire
longitudinale. »
Comme je le fais régulièrement, voici un
florilège qui démontre la richesse de l’écriture de Jean Lemieux :
« Le vent d’est et le ciel bas s’accordaient à
l’humeur du vétéran du SPVM. »
« Les jours étaient courts, les belles
blancheurs de février n’étaient pas plus en vue que le Cap-Breton. »
« Delphine Schofield fixa sur lui ses hublots
céruléens... »
« La cheffe influenceuse figea comme une
béchamel oubliée sur le comptoir. »
« Il était tombé une trentaine de centimètres
de neige, lesquels centimètres se soustrayaient, s’additionnaient en creux et en
bosses selon les poussées d’un lourd vent d’est. »
« Avec sa moustache, ses cheveux mi-longs de
travers, Octave Loiseau ressemblait à un mousquetaire surpris en train de
trousser une soubrette. »
« L’âge, c’est comme la photographie, c’est
une question de point de vue. »
« Mêlés à une gueule de bois modérée, des
souvenirs du souper de la veille crevaient comme des bulles grasses à la
surface de ses pensées. »
« Dans la police, il faut avoir des yeux tout
le tour de la tête, se méfier des bandits, mais aussi de nos collègues. »
« L’affaire
des Montants », se termine sur une fête de Noël « surprenante »
à Iberville, un « un souper
tranquille », chez sa mère Nicole rongée par un cancer. Tôt, le
lendemain matin, le sergent détective, devant l’arbre de Noël encore allumé où « la vraie crèche de Noël [que sa mère] dépoussiérait tous les 10 décembre depuis
cinquante ans [repose] toujours au
milieu des Rois mages et des confettis » se fait songeur sur l’avenir
d’un des personnages de son enquête et sur ses propres origines familiales :
« Dans cette histoire, dont la sienne,
Surprenant, il y avait une mère, mais aussi un enfant. Attendue, inattendue,
désirée, redoutée, chaque naissance refaisait, défaisait le monde, dans un
tourbillon perpétuel. »
Si vous ne vous précipitez pas pour vous
procurer votre exemplaire chez votre librairie indépendante ou pour emprunter une
copie papier ou numérique auprès de votre bibliothèque publique, vous vous
priverez du plaisir de lire très certainement l’un des meilleurs tomes à ce
jour de la série imaginée par Jean-Lemieux.
* * * * *
Médecin, passionné de musique et de voyage, Jean Lemieux a écrit de nombreux romans lauréats de multiples prix. En 2020 est paru « Les Demoiselles de Havre-Aubert », la sixième enquête d’André Surprenant. La série a débuté en 2003 avec « On finit toujours par payer », qui a remporté les prix France-Québec et Arthur-Ellis avant d’être porté à l’écran. Jean Lemieux a également publié « Une sentinelle sur le rempart », un récit autobiographique sur son expérience d’omnipraticien, de même que « La Marche du Fou » et « Prague sans toi », qui explorent les thèmes de l’amour et du voyage. Pour les jeunes, il est notamment l’auteur du « Trésor de Brion », une chasse au trésor aux Îles-de-la-Madeleine.
Je tiens à remercier les éditions Québec
Amérique pour l’envoi du service de presse.
Au Québec, vous pouvez commander votre
exemplaire du livre via la plateforme leslibraires.ca
et le récupérer dans une librairie indépendante.
Originalité/Choix du sujet :
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
Qualité littéraire :
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
Intrigue :
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
Psychologie des
personnages :
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
Intérêt/Émotion
ressentie :
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
Appréciation générale
:
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |

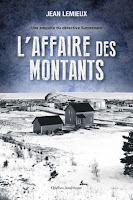


Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire